par Marie TINARD, étudiante du Master 2 Droit des communications électroniques
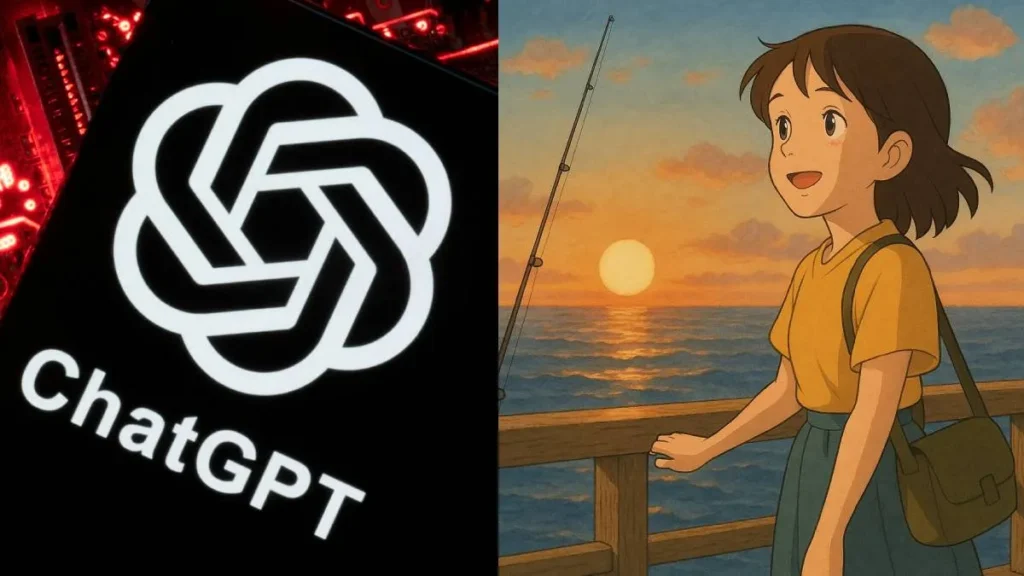
Et si les dessins de Miyazaki qui ont marqué l’enfance de nombre d’entre nous n’étaient plus uniquement le fruit d’un crayon, mais aussi celui de l’intelligence artificielle ?
C’est la situation inédite à laquelle le Studio Ghibli s’est vu confronté. Cofondé en 1985 par Hayao Miyazaki, le studio s’est vite imposé comme un pilier de l’animation japonaise et a popularisé à travers ses films un style très reconnaissable marqué par des couleurs chaudes, des personnages aux contours simples et arrondis qui contrastent avec des environnements très détaillés. Dès ses débuts, le studio marque les esprits avec Le Château dans le ciel (1986) et Mon Voisin Totoro (1988) qui deviennent des références mondiales.
Grâce à l’IA, une inondation de plusieurs millions de dessins reproduisant le style de Miyazaki est apparue sur les réseaux sociaux. Le fautif ? Chatgpt, une intelligence artificielle développée par la société américaine OpenIA, une des plus utilisées dans le monde, capable de répondre à des questions et de rédiger des textes. Depuis le 25 mars 2025, Chatgpt intègre une nouvelle fonctionnalité de génération d’image, un procédé simple qui consiste à dicter des instructions afin que soit généré le dessin souhaité. Dans un secteur comme celui de l’animation où l’emprunte de la personnalité de l’auteur a toujours primé, l’arrivée de l’IA pourrait bien bousculer les frontières de la création.
Alors quels risques juridiques soulèvent ces reproductions des œuvres du Studio Ghibli par un système d’IA générative ?
Le regard critique de la jurisprudence relatif à l’entraînement de l’IA sur l’héritage du Studio Ghibli
Lorsque l’on regarde ces images générées par l’IA, il est assez évident que la signature visuelle du Studio Ghibli a été détournée par les utilisateurs des réseaux sociaux. Les versions enfantines et adoucies, souvent produites à partir de photographies données elles-mêmes par les utilisateurs, perdent le caractère dramatique propre au style de Miyazaki. Alors dans ce contexte, existe-t-il une atteinte au droit d’auteur du studio ?
Il convient de rappeler que le style n’est pas protégé par le droit d’auteur. Par conséquent, une œuvre générée dans un style donné (par exemple dans celui du Studio Ghibli) ne porte pas atteinte tant qu’elle ne produit pas à l’identique des éléments propres à des œuvres protégées. Toutefois, l’atteinte peut survenir en amont, durant la constitution des bases de données qui sont utilisées pour l’entraînement de l’IA. C’est ici que réside le problème : il est presque certain que Chatgpt a utilisé des images ou des plans issus des films du studio pour en copier les éléments caractéristiques. Les programmes d’IA s’entraînent grâce à des dataset, composés d’immenses bases de données, et OpenIA s’est entraîné avec un programme de dataset composé de 5,85 milliards d’images. Si des œuvres protégées y sont intégrées sans l’autorisation préalable de leurs titulaires de droits, la violation des droits d’auteur réside alors dans l’exploitation illicite de ces œuvres.
Sur ce point, le regard de la jurisprudence est intéressant. L’arrêt « Pelham 1 » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 29 juillet 2019 a par exemple affirmé que le fait d’échantillonner un contenu protégé au travers du processus de sampling n’est pas une atteinte au droit de reproduction et de représentation si l’échantillon ne permet pas de reconnaître le contenu d’origine. Ainsi, le plus important réside dans le caractère reconnaissable de l’échantillon : s’il est impossible d’identifier le contenu d’origine, l’usage ne correspondra pas à une reproduction illicite.
Mais l’arrêt Pelham ne répond pas entièrement à la problématique posée par l’entraînement de l’IA. C’est précisément sur ce point que la jurisprudence récente du Tribunal de Munich vient compléter cette réflexion. Dans une décision concernant OpenAI et rendue en ce mois de novembre, il a estimé que l’entreprise américaine avait violé des droits d’auteur en entraînant ses modèles sur des paroles de chansons protégées. Cette « mémorisation » constitue, selon le tribunal, une fixation au sens du droit d’auteur et donc une reproduction illicite.
Ces décisions différencient deux procédés : l’échantillonnage et la mémorisation. Si l’arrêt Pelham admet qu’un échantillon modifié n’emporte pas reproduction, la décision du tribunal de Munich confirme qu’une IA qui « mémorise » des œuvres protégées dans ses paramètres réalise une fixation constitutive d’une reproduction illicite. Ainsi, même si cette décision reste pour le moment isolée et non confirmée par une juridiction supérieure, il est possible de l’interpréter au cas d’espèce et d’en déduire que la « mémorisation » par OpenIA d’œuvres originales du Studio Ghibli pourrait constituer une atteinte aux droits d’auteur.
Des enjeux économiques non négligeables pour OpenIA
La mode Ghibli a largement profité à OpenIA provoquant un pic d’activité sur la plateforme qui a rassemblé jusqu’à 151 millions d’utilisateurs. L’entraînement d’OpenAI sur le style visuel distinctif du Studio Ghibli soulève donc des questionnements puisque les systèmes d’IA tirent des fruits de ces images extraites de contenus protégés et il est normal que les titulaires de droits en profitent également.
En réutilisant sans autorisation les œuvres originales du studio, les contenus générés peuvent concurrencer les œuvres originales. Comme l’explique le Sénat dans son Rapport d’information de juillet 2025, ces nouveaux contenus « entrent directement en concurrence avec les œuvres humaines ayant servi à leur élaboration ». Juridiquement, cette appropriation peut être qualifiée de concurrence déloyale car un acteur économique (le fournisseur d’IA) tire bien des profits des investissements artistiques et de la réputation du Studio Ghibli sans contribution équitable ce qui constitue une source de préjudice.
Il peut être intéressant de mettre cette situation en perspective avec les quatre rapports de juin 2025 rendus par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique qui abordent l’idée d’un mécanisme de rémunération minimale des titulaires de droit. Cette rémunération serait versée par les fournisseurs de systèmes d’IA générative et constituée sur les contenus qui auraient servis à l’entraînement. L’idée est de défendre la dimension préventive des droits de propriété intellectuelle et de garantir que les titulaires de droit soient davantage associés aux bénéfices issus de l’entraînement des systèmes d’IA.
Les différentes protections juridiques offertes pour contrer l’IA
Les atteintes aux droits d’auteur ne résident donc pas uniquement dans les contenus créés mais peuvent aussi résulter de l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées au moment de l’entraînement de l’IA. Cet entraînement est régulé par la Directive sur le marché unique numérique de 2019. Son article 4 autorise la fouille de données (text and data mining) à des fins d’entraînement, y compris sur des contenus protégés, sauf si les ayants droit exercent leur droit d’opt-out. Ce mécanisme permet aux créateurs de s’opposer à l’exploitation de leurs œuvres.
De plus, la réglementation a également été renforcée par l’IA Act qui impose aux fournisseurs d’IA de publier un résumé détaillé des données utilisées pour l’entraînement de leurs systèmes consolidant ainsi leur devoir de transparence. La Commission européenne a aussi publié un Code de bonnes pratiques des systèmes d’IA déjà signé par 28 développeurs dont Open IA.
D’autres acteurs tentent à leur tour de défendre les œuvres protégées comme Ben Zaho, professeur en sécurité informatique de l’Université de Chicago qui développe des outils technologiques dans le but de protéger les artistes des intelligences artificielles. Son programme intitulé « Glaze », grâce à quelques changements imperceptibles à l’œil humain, empoisonne les pixels qui composent les images empêchant ainsi l’IA de capturer ce qu’elle souhaite imiter.
Enfin, ce phénomène planétaire qu’est la « mode Ghibli » interroge le statut juridique des œuvres générées par l’IA tout en mettant en lumière les tensions entre innovation technologique et préservation de l’identité artistique. Miyazaki affirmait lui-même : « Je ne veux pas intégrer cette technologie à mon travail, je considère que c’est une insulte à la vie ». La création de Princesse Mononoke avait nécessité pas moins de trois ans de travail et 144 000 dessins, une fabrication lente et aux antipodes de l’usage immédiat et récréatif proposé par Chatgpt. Il est donc primordial de continuer à renforcer le cadre réglementaire qui régit les pratiques des fournisseurs d’IA dans un souci de protection des droits des créateurs.
Sources :
- Arte.tv, « Le Dessous des images : le buzz mondial lié à la génération de vidéos dans le style du Studio OpenAI Ghibli », 2025.
- Village Justice, « Imiter Ghibli est voler Ghibli ? Le droit d’auteur face au style », 1er avril 2025.
- EUR-Lex, « Arrêt Pelham 1 – CJUE du 29 juillet 2019 », 29 juillet 2019.
- N°42 O 14139/24, Tribunal de Munich, 11 novembre 2025.
- HAAS Avocats, « Décision N°42 O 14139/24 concernant OpenAI et droits d’auteur », Novembre 2025.
- IA Act, « Article 4 : Maîtrise de l’IA – Loi européenne sur l’intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689) », 2025.
- Sénat, « Rapport d’information sur les enjeux de l’IA dans la propriété intellectuelle », juillet 2025.
- DDG, « IA & propriété intellectuelle : enseignements du buzz mondial lié à la génération de vidéos dans le style du Studio OpenAI Ghibli », 2025.
- YouTube, « Hayao Miyazaki s’exprimant sur l’intelligence artificielle dans la création », 2016.
Marie Tinard, étudiante en Master 2 Droit des communications électroniques